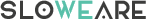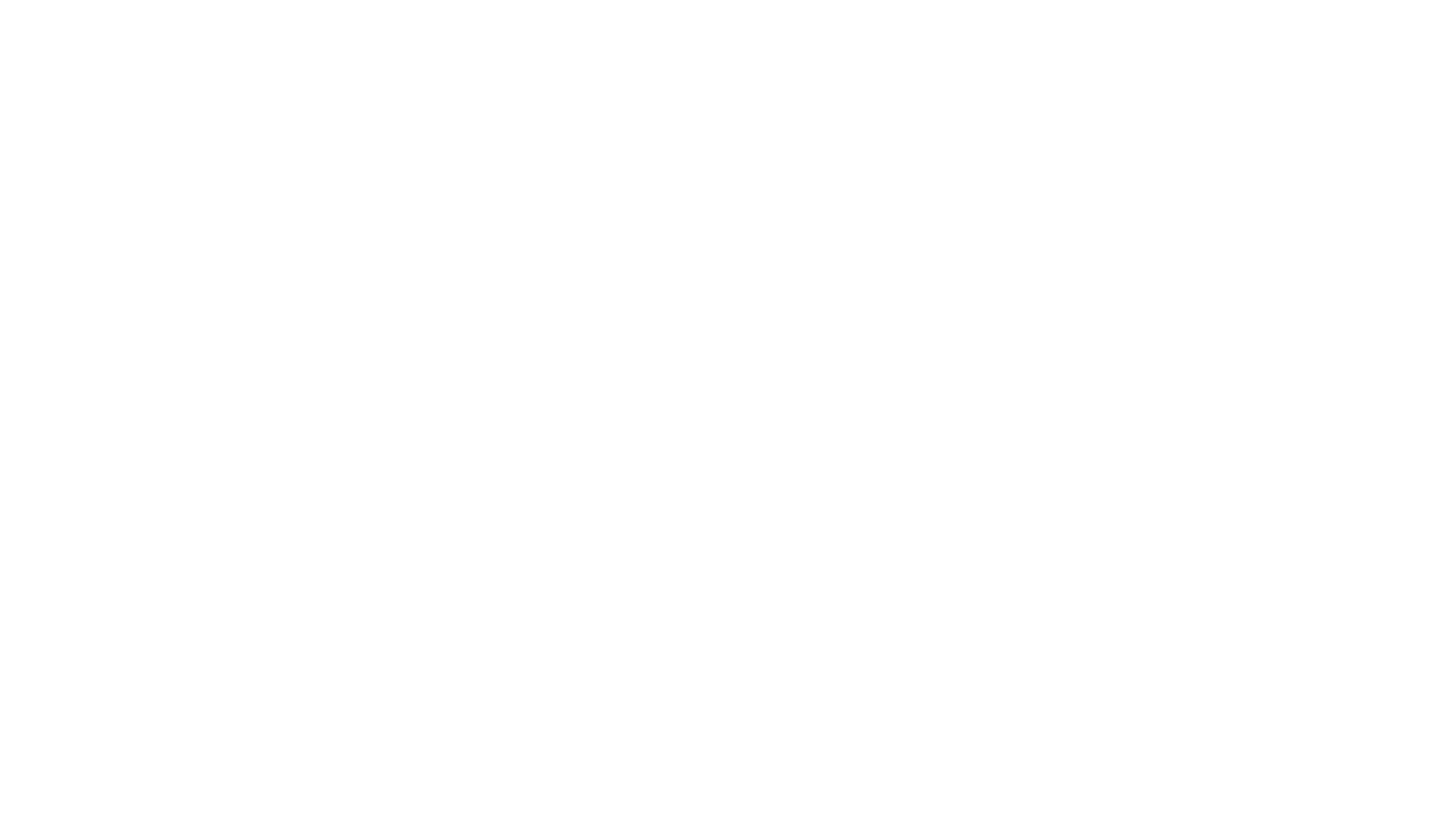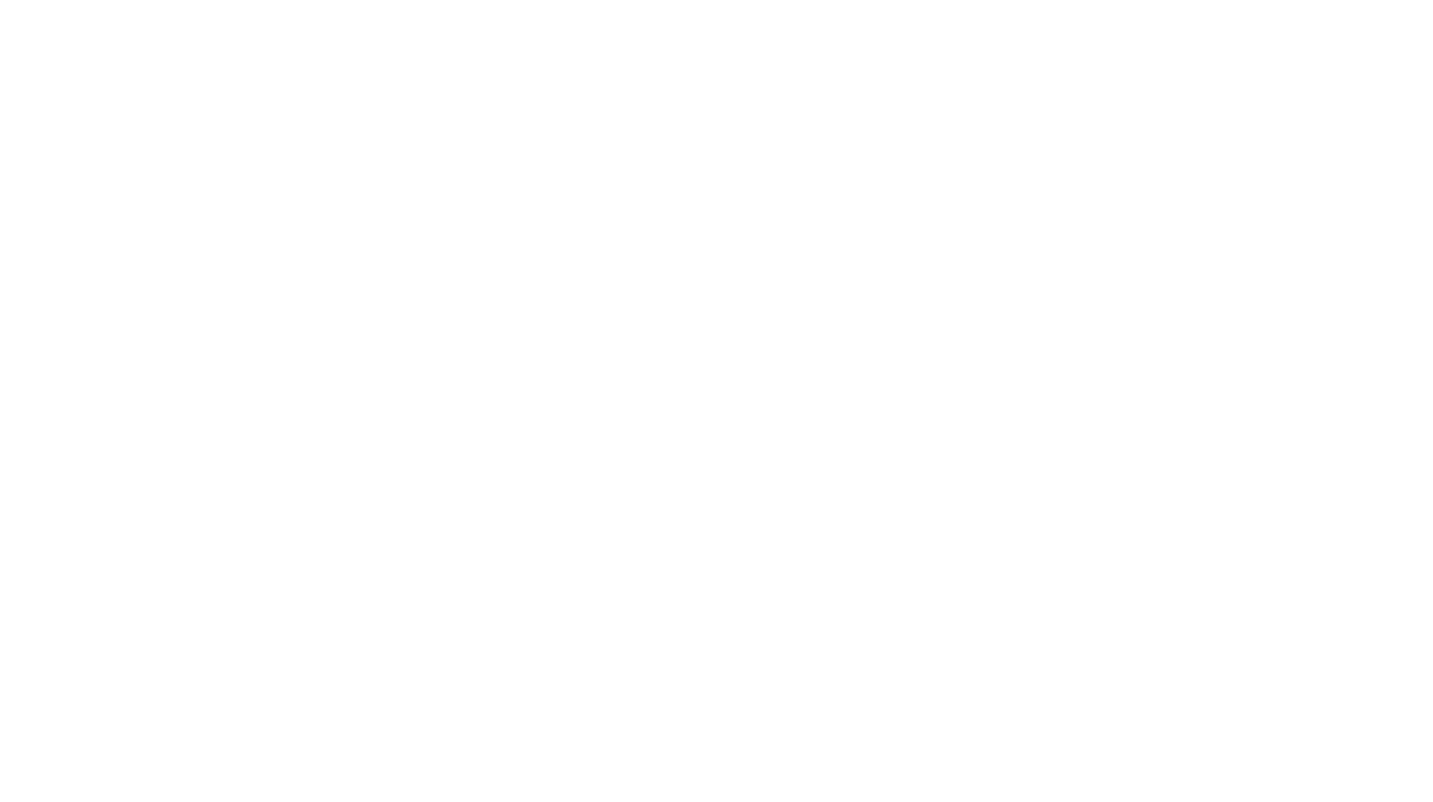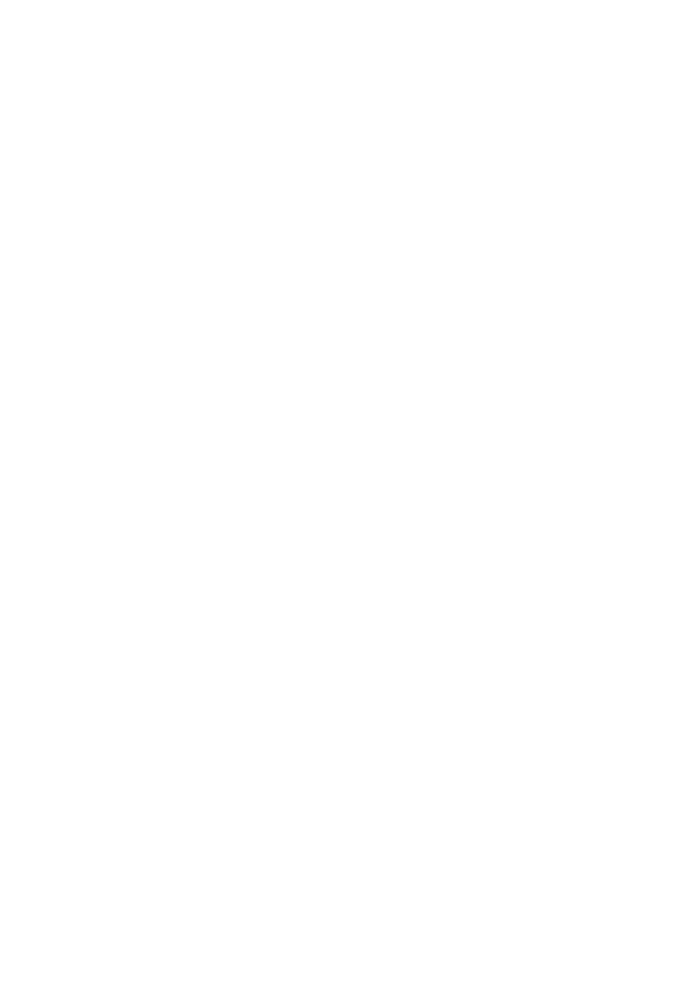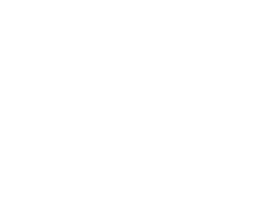Mal-être humains et aberrations écologiques : les défis des Fashion Week
les défis des Fashion Week
Fashion Week : Mal-être humains et aberrations écologiques
Les défis des Fashion Week
Défis des Fashion Week
Salariés sous pression, dépendants de décisionnaires rois, entorses au droit du travail et désintérêt de logiques écologiques basiques… Certaines maisons de couture ont la réputation de mépriser des pratiques sociales et environnementales élémentaires. Nous avons recueilli les témoignages de trois jeunes femmes sur l’envers du décor des Fashion Week. Nous avons voulu savoir dans quelle mesure le luxe se préoccupe aujourd’hui de bien-être et d’environnement dans ses bureaux parisiens.
Annie[1] a été responsable de développement produit chez trois grandes maisons de couture avant de quitter le milieu il y a un an et demi pour lancer son entreprise centrée sur le bien-être.
Colette a travaillé comme assistante de production. Elle était responsable de développement de vêtements VIP et broderies dans deux grandes maisons. Elle finit par s'en détourner à partir de 2015 pour passer peu à peu à la mode éco-responsable.
Estelle a été assistante d’une directrice de collection et du développement des tissus. Elle crée sa propre marque en 2008 et n’utilise que des matériaux écologiques.
Quand le rêve se transforme en cauchemar
Toutes trois ont été frappées par la capacité du milieu à broyer des vocations.
« Dans une des maisons pour lesquelles j’ai travaillé, le DA (directeur artistique) voulait que toutes les filles portent des talons quand il était là. »
« Pour son successeur, il fallait que tout le monde prenne les escaliers de service, il ne voulait croiser personne. »
Estelle, Annie et Colette pourraient raconter ce genre d’anecdotes à la pelle. Cela ne les fait pas vraiment sourire. Au-delà de ces caprices, les décisions unilatérales pouvant impacter toute la chaîne de production sont légions, d’après leurs témoignages.
Créativité et DA rois : la loi de la dernière minute
« Pour les collections de défilé ou les pré-collections, raconte Annie, nous devions produire très rapidement. Le DA décidait parfois de changer au dernier moment un des tissus. Nous devions ainsi refaire intégralement le vêtement, parfois du jour au lendemain. Nous n’avions pas le temps d’attendre un transporteur express. On envoyait alors quelqu’un faire le tour des fabricants en Europe en camion pendant toute la nuit. Les ateliers fabriquaient la tenue illico. Il arrivait aussi d’envoyer en avion une stagiaire pour aller chercher une robe en Italie par exemple… C’est bien joli de développer des capsules green si derrière on dépense un aller/retour en avion pour aller chercher une tenue… » s’agace-t-elle.
Ces moments de pressions intenses sur les délais semblent la règle en période de Fashion Week, avec des conséquences humaines comme financières. « Si un(e) DA demandait par exemple trois semaines avant le défilé de faire des galons (des bandes de tissus assez épaisses posées près des coutures pour les renforcer ou en ornement, ndlr), cela représentait des coûts à hauteur de 50 000€. Alors que dans le même temps, la moitié de la maison se faisait licencier. »
Chutes et logo : le gâchis matériel
Ces changements de dernière minute signifient que beaucoup de tissus commandés ne sont jamais utilisés. De même les chutes de tissus ne sont pas réinvesties d’une saison sur l’autre dans l’immense majorité des cas, l’obsession de la mode conventionnelle étant la tendance future. Elles sont cependant accessibles pour d’autres créateurs : « J’ai déjà pu acheter des chutes de tissus de grandes maisons » explique Colette qui a créé sa propre marque, éco-responsable.
« Des trucs qui traînaient depuis plusieurs saisons. Mais s’il y a un logo ou si c’est identifiable à une collection, on ne peut pas l’utiliser. »
« Ce que j’ai vu de choquant, poursuit Colette, c’est quand on demandait à des stagiaires de découper des vêtements en petits morceaux, parce qu’ils n’étaient pas parfaits, sous prétexte que ça pouvait dégrader l’image de la marque si on les avait vus portés. (…) Il n’y a pas de logique écologique en studio de création » assure-t-elle.
Colette tempère la notion de gâchis lié à la création luxe : « C’est un peu dérisoire par rapport à la fast fashion, vu le petit nombre de vêtements produits, et le fait que la production est souvent réalisée en France, en Italie ou au Portugal ». Globalement le marché est plus local que pour le reste de l’industrie. Même si d’après les propos d’Annie, les vêtements présentés en boutique peuvent venir de pays de l’Est comme de Chine.
Nuits blanches et zéro ego : la bulle des Fashion Week
Les documentaires de Loïc Prigent[2] donnent une idée de la frénésie qui règne dans une maison de couture à l’approche des Fashion Week. Souvent présentée comme une période excitante, elle peut aussi être vécue comme une épreuve.
« C’était l’enfer sur terre, se souvient Annie évoquant une de ses expériences dans une maison renommée. C’étaient six ou sept semaines d’affilée sans week-end, en terminant à 1 heure du matin. Derrière nous avions quatre jours de pause. ».
Colette évoque aussi les nuits blanches avant les défilés et se souvient de maisons qui réservaient des hôtels afin que les employés n’aient pas à rentrer chez eux et puissent travailler plus tard le soir et plus tôt le matin. Une grande maison se serait faite épingler par l’inspection du travail pour avoir installé des lits de camps sur place, dans le même objectif.
Défis insurmontables des Fashion Week
« D’ordinaire on faisait 80h par semaine, raconte quant à elle Estelle. En période de Fashion Week ou pré-collection, pendant un mois non-stop, on restait le samedi et le dimanche. Tout le monde faisait ça, donc ça semblait normal. Les gens ne faisaient pas de pause dej’, ils disaient : « Je n’ai pas faim, je grignote un truc devant mon ordi. » Psychologiquement, tu n’existes plus. Tu ne fais plus tes courses, tes lessives. Tu vis dans une bulle. »
Le Calendrier des Fashion Week extrait du documentaire de Loïc Prigent « 52 minutes de mode » (2018). Certaines marques y ajoutent des inter-collections.
See now buy now
« Le défi de la mode, c’est de fabriquer toujours plus vite, si possible de livrer en boutique le lendemain du défilé, explique encore Estelle, pour couper l’herbe sous le pied à la concurrence ». C’est ce qu’on appelle le See now buy now, pratique lancée en 2016 par Burberry pour permettre à la clientèle de s’offrir illico la tenue convoitée, sans attendre les quelques mois considérés jusqu’alors comme nécessaires pour répondre à la demande sur une collection luxe. Les employés ont donc des chances de subir les conséquences de ce nouveau rythme.
Culte de la beauté & machisme
Sans grande surprise, les trois jeunes femmes ont expérimenté un milieu grossophobe, propice à sélectionner ses collaborateurs sur le physique. « La laideur est très rejetée, raconte Colette. Ça ne passe pas, même si on est très efficace. En revanche, si tu es un peu beau et un peu cool, ce n’est pas très grave si tu es inefficace. »
Globalement, la mode est très machiste poursuit-elle : « Les filles doivent être hyper belles, hyper minces, hyper inspirantes ». Annie nous parle également de discrimination à l’embauche avec des CV de jeunes femmes blondes que son manager lui avait demandé de sélectionner, dans une maison qui souhaitait que ses employés ressemblent à ses égéries.
« J’ai découvert que le métier de mes rêves était un grand mensonge, conclut Estelle. Ce qu’on nous montre dans les bouquins d’histoire de la mode, dans les magazines, ça n’existe plus. L’argent est mis dans les charges marketing. Le but est simplement d’ouvrir un maximum de boutiques et de faire du chiffre. L’esprit parisien n’existe plus » tient-elle à ajouter pour clore notre entretien.
les défis des Fashion Week
Mépris des RH vs engagement sociaux : les variations de traitement
Hélène Sarfati-Leduc, conseillère indépendante auprès d’entreprises de mode et luxe spécialisée dans le développement durable, connaît bien la problématique. Non seulement en tant que consultante et observatrice, mais aussi pour avoir vécu ce type d’expériences au temps où elle-même travaillait dans le marketing pour les mêmes maisons. « Moi, j’ai pu m’opposer et refuser de rentrer à pas d’heure tous les soirs, parce que j’avais 34 ans. Mais c’est une vraie violence surtout quand on est plus jeune. J’en ai gardé des phobies ». Selon elle, on ne peut pas généraliser les constats. « Certaines maisons sont réputées pour être plus dures, et toutes n’ont pas cette culture du directeur artistique tout puissant. Chez Chanel, par exemple, c’est plus familial, globalement. D’ailleurs, ils ne communiquent pas tellement là-dessus, mais ils ont noué un partenariat avec un accélérateur d’innovations sociales. »
Défis des Fashion Week
Nathalie Lemesle, conseillère en ressources humaines auprès de ces mêmes maisons, anciennement employée chez LVMH, reconnaît que ces problématiques de burn out et de pressions intenses sont connues, et difficiles à régler. D’après elle, on ne donne pas assez de puissances aux équipes des ressources humaines. « C’est important que toutes les équipes créatives passent par la RH pour le recrutement et ne fassent pas que du copinage » note-t-elle, évoquant une pratique de favoritisme considérée comme un délit dans le secteur public mais non pénalisée dans le privé. L’épanouissement des salariés passe généralement par des entretiens d’appréciation et des plans de développement dont ne se préoccupent guère les instances créatives d’après elle.
L’air du burn out : démissions et dénonciations
Ces dernières années, les brusques départs de plusieurs directeurs artistiques ont contribué à une prise de conscience du grand public concernant la pression commerciale imposée à un secteur par essence créatif, qui retombe mécaniquement sur les épaules des employés. Le burn out de Christophe Decarnin chez Balmain en 2011, le dérapage incontrôlé de John Galliano chez Dior la même année, la démission de Raf Simons chez Dior et le départ d’Albert Elbaz de Lanvin en 2015. Ces deux derniers avaient évoqué clairement les rythmes de productions accélérés peu compatibles avec celui de la création. « Tout est fait en trois semaines, cinq semaines maximum » déplorait le créateur belge peu après son départ de la maison française[3].
La dénonciation des conditions de travail dans la mode n’est pas nouvelle, elle a notamment eu une belle visibilité via l’expérience des mannequins, pas toujours majeures, poussées à la maigreur, (mal)traitées comme des objets, participant rarement à plus d’une saison de défilés, abusées physiquement comme moralement. Le documentaire Picture Me (2010) réalisée par la mannequin américaine Sara Ziff fait partie des éléments de dénonciations qui ont abouti à des législations dans plusieurs pays, dont la France en 2017, ainsi qu’à la mise en place de chartes de protection des mannequins chez Kering et LVMH.
Faut-il légiférer ?
Le même mouvement dénonciation ⇒ prise de conscience ⇒ législation pourrait bien s’opérer pour d’autres corps de métier : « Les maisons qui font des efforts aujourd’hui le font parce qu’elles veulent éviter d’abîmer leur réputation, pour éviter les burn out et ne pas perdre des personnes importantes dans leur organisation, remarque Hélène Sarfati-Leduc. La meilleure façon d’arriver à un résultat c’est la contrainte réglementaire. » Elle évoque entre autres des pratiques américaines de recrutement par téléphone qui règlent la question des discriminations au physique.
Affiche américaine du documentaire d’Ole Schell et de la mannequin Sara Ziff, Picture Me, a model’s diairy (Strand Releasing - 2010)
Défis des Fashion Week
Des solutions : rationalisation et pression législative
Giulia Mensitieri, anthropologue auteure de l’ouvrage Le plus beau métier du monde [4], a dévoilé dans son livre les coulisses des maisons de luxe, faites de précarité et de rêve. On y lit les histoires de travailleurs qui, qu’ils soient couturiers, stylistes, stagiaires communication ou maquilleurs, sont prêts à tout et notamment à travailler gratuitement pour faire partie de cette industrie.
Le double statut d’industrie créative et de profits crée une tension structurelle à l’origine de bien des maux, depuis les déceptions de jeunes hommes et femmes qui s’épuisent vite une fois décroché le Graal d’un job dans le secteur convoité, jusqu’au travail nocturne d’ouvriers dont nos trois témoins doutaient fortement qu’ils bénéficient d’aucune forme de protection sociale. « Les abus existent, reconnaît Nathalie Lemesle qui poursuit : c'est au dirigeant de dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables. »
Les équipes RH seules n’ont, selon elle, pas le pouvoir d’imposer grand-chose dans la machine à rêve. « On s’occupe de reconnecter les jeunes postulants avec la réalité du travail fourni et de leurs compétences pour que les salariés soient moins dans une relation hystérique et surinvestie avec l'endroit ». Mais selon elle, pour espérer faire disparaître ces abus, il faudrait d’une part réduire le nombre de collections annuelles, d’autre part former les managers à leurs fonctions et mettre des RH dans les comités de direction.
Le scandale, moteur du changement
Sur la partie environnementale, ce sont aussi des questions de réputations qui font progresser les choses. Exemple cet été, quand il a été révélé que Burberry avait brûlé pour 31 millions d’euros de vêtements et produits cosmétiques sur l’exercice 2017-2018. Ce scandale a débouché en septembre sur l’annonce de l’arrêt du brûlage des invendus. En septembre également, le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé le travail sur une loi interdisant de jeter ou brûler ses invendus, sous la pression d’Emmaüs.
D’après Hélène Sarfati-Leduc, les marques subissent aussi une pression sur la rentabilité financière qui les pousse à lutter contre le gaspillage de matière première.
« Les choses se rationalisent. Chanel, par exemple, travaille sur tout ce qui est recyclage de décors des vitrines. Tout ça est tiré par la réglementation, l’économie et l’image. Les entreprises sont obligées de prendre en compte le principe du pollueur-payeur. » On pense à la loi sur le Devoir de Vigilance qui touche les très grosses entreprises françaises.
« Tout est en train de se durcir. L’encouragement ne suffit pas. » conclut Hélène Sarfati-Leduc, s’ancrant dans un mouvement qui refuse l’unique culpabilisation du consommateur et remet l’arsenal législatif et la responsabilité des entreprises au cœur du problème.
[1] Les prénoms ont été changés.
[2] Notamment ses séries « Le jour d’avant ».
[4] Le plus beau métier du monde - Dans les coulisses de l’industrie de la mode, de Giulia Mensitieri - Éd. La découverte, 2018.
Slowez-nous ! Partagez la Slow Attitude avec les personnes que vous aimez